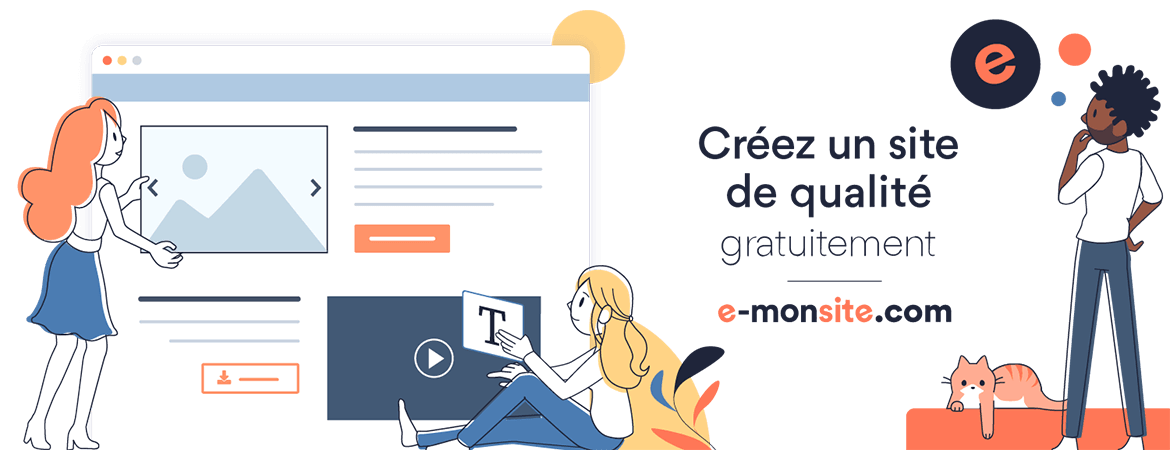visant à exiger une distance minimale de 1 000 mètres
entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités
et les zones destinées à l’habitation,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il y a dix ans, les territoires ruraux accueillaient l’implantation d’éoliennes comme un élément de modernité et un atout en termes de recettes fiscales, puisque les communes sur les territoires desquelles les projets voyaient le jour bénéficiant d’importantes rentrées en termes d’impôts.
L’enthousiasme et l’effet de mode sont aujourd’hui passés et même le caractère d’énergie de substitution des éoliennes géantes est de plus en plus sujet à caution.
Dans le même temps, les remontées des territoires sont très négatives et les élus locaux expriment aujourd’hui un grand désarroi face aux pressions conséquentes qu’exercent les promoteurs pour installer de plus en plus de machines dont la hauteur ne cesse d’augmenter.
La Cour des Comptes a souligné cette dérive dans son rapport du 25 juillet 2013 – les maires se livrant, pour des raisons fiscales, à une sorte de course à l’éolien - et le service central de prévention de la corruption a alerté les pouvoirs publics en juillet 2014 sur la multiplication des « prises illégales d’intérêts » d’élus locaux impliqués dans le développement de la filière éolienne.
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180, 200, voire 210 mètres, des hauteurs telles qu’il est apparu un peu partout en Europe que leur présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale se double d’une véritable question de santé publique puisque l’Académie nationale de médecine a recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
Les nuisances des éoliennes pour les riverains sont en effet connues : bruits lancinants provoqués par le passage des pales devant les mâts ou par le sifflement du vent dans les pales, flash lumineux, effets stroboscopiques, encerclement des habitations et effet d’écrasement.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet d’aménagement du territoire. Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet d’un véritable mitage ; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Les débats intervenus au Sénat lors de la discussion de la loi de transition énergétique ont permis de mettre en évidence que certains États ou certaines entités locales ont adopté des règles plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres.
Ainsi, au Danemark, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne et aux États-Unis, les comtés de Californie ont instauré des distances variant de une à quatre fois la hauteur de l’éolienne, trois fois étant la norme standard. Par ailleurs en Suède, certaines communes imposent une installation à 750 mètres des habitations et d’autres à 1 000 mètres.
Notre pays ne peut rester à l’écart de ce mouvement responsable en maintenant le principe d’une distance de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à exiger une distance minimale de 1 000 mètres entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à habitation, afin de favoriser la concentration des parcs éoliens dans des zones inhabitées.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, substituer au nombre : « 500 » le nombre : « 1 000 ».
============================================================================================================================================AMENDEMENT REJETE
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2018
LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 971)
Commission
Gouvernement
Rejeté
AMENDEMENT N o 30
présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont,
M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson,
M. Menuel, M. Parigi, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Vialay
et M. Jean-Pierre Vigier
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, le
nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il y a dix ans, les territoires ruraux accueillaient l’implantation d’éoliennes comme un élément de
modernité et un atout en termes de recettes fiscales, les communes sur les territoires desquelles les
projets voyaient le jour bénéficiant d’importantes rentrées en termes d’impôts.
L’enthousiasme et l’effet de mode sont aujourd’hui passés et même le caractère d’énergie de
substitution des éoliennes géantes est de plus en plus sujet à caution.
Dans le même temps, les remontées des territoires sont très négatives et les élus locaux expriment
aujourd’hui un grand désarroi face aux pressions conséquentes qu’exercent les promoteurs pour
installer de plus en plus de machines dont la hauteur ne cesse d’augmenter.
La Cour des comptes a souligné cette dérive dans son rapport du 25 juillet 2013 – les maires se
livrant, pour des raisons fiscales, à une sorte de course à l’éolien - et le service central de prévention
de la corruption a alerté les pouvoirs publics en juillet 2014 sur la multiplication des « prises
illégales d’intérêts » d’élus locaux impliqués dans le développement de la filière éolienne.
APRÈS ART. 23 N° 30
2/2
Les éoliennes deviennent de plus en plus imposantes et atteignent désormais 120, 140, 160, 180,
200, voire 210 mètres, des hauteurs telles qu’il est apparu un peu partout en Europe que leur
présence devenait intolérable à une distance de 500 mètres des habitations.
Il existe effectivement clairement un problème d’acceptabilité sociale et les implantations
d’éoliennes sont de plus en plus perçues comme des agressions. Cette acceptabilité sociale se
double d’une véritable question de santé publique puisque l’Académie nationale de médecine a
recommandé en 2006 une distance de protection de 1 500 mètres.
Les nuisances des éoliennes pour les riverains sont en effet connues : bruits lancinants provoqués
par le passage des pales devant les mâts ou par le sifflement du vent dans les pales, flashs lumineux,
effets stroboscopiques, encerclement des habitations et effet d’écrasement.
La multiplication des implantations d’éoliennes est également un sujet d’aménagement du territoire.
Les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l’objet
d’un véritable mitage ; un mitage qui s’accompagne pour les propriétaires de biens immobiliers
d’un phénomène de dévalorisation de leur patrimoine.
Les débats intervenus au Sénat lors de la discussion de la loi de transition énergétique ont permis de
mettre en évidence que certains États ou certaines entités locales ont adopté des règles plus
contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres.
Ainsi, au Danemark, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne et aux
États-Unis, les comtés de Californie ont instauré des distances variant de une à quatre fois la
hauteur de l’éolienne, trois fois étant la norme standard. Par ailleurs en Suède, certaines communes
imposent une installation à 750 mètres des habitations et d’autres à 1 000 mètres.
Notre pays ne peut rester à l’écart de ce mouvement responsable en maintenant le principe d’une
distance de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation, les immeubles
habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme.
C’est pourquoi le présent amendement vise à exiger une distance minimale de 1 000 mètres entre
les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation, afin de
favoriser la concentration des parcs éoliens dans des zones inhabitées.

N° 1005
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité et l’information des populations riveraines de parcs éoliens,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Nicolas FORISSIER, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Jean-Luc REITZER, Bérengère POLETTI, Thibault BAZIN, Jean-Pierre DOOR, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BAZIN-MALGRAS, Daniel FASQUELLE, Jean-Carles GRELIER, Patrice VERCHÈRE, Franck MARLIN, Marie-Christine DALLOZ, Michel VIALAY, Pierre CORDIER, Émilie BONNIVARD, Damien ABAD, Pierre-Henri DUMONT, Véronique LOUWAGIE, Maxime MINOT,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Afin de prendre en compte les changements climatiques, la France souhaite accélérer la mise en œuvre des Accords de Paris en déployant son Plan climat, présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire le 6 juillet 2017. Ce plan vise notamment à en finir avec les énergies fossiles et à développer les énergies renouvelables, au rang desquelles figure en bonne place l’éolien. Cette dernière option est, depuis de nombreuses années, régulièrement mise en avant pour permettre à la France de respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Massivement subventionné, ce qui peut susciter des interrogations au regard du coût à terme de l’électricité ainsi produite, l’éolien est ainsi la source d’énergie qui a le plus progressé ces dix dernières années, la deuxième source de production d’électricité renouvelable. Sa part dans le mix énergétique français reste faible malgré tout, de l’ordre de 4 %. Dépendante de conditions climatiques pouvant fortement varier, contrainte par une fourchette de vitesses de vents restreinte, une éolienne tourne rarement à sa puissance maximale. Afin de pallier ce défaut structurel, l’on assiste donc aujourd’hui à une course à la puissance qui se traduit par le gigantisme des installations. Or, si les techniques ont considérablement évolué, tel n’est pas le cas de la législation.
Le cadre normatif actuel n’est en effet plus adapté à des installations qui n’ont plus grand chose à voir avec celles pour lesquelles il a été conçu, et dont les effets sont mieux connus. Visibles à plus de 20 km à la ronde, les modèles les plus imposants dépassent aujourd’hui 200 m de hauteur, pour un rotor de plus de 160 m de diamètre. Du fait de la dénaturation du paysage, en particulier lors d’une accumulation trop importante de machines, l’effet sur le développement économique et sur le tourisme local, qui s’appuient particulièrement sur le cadre de vie proposé, est désormais très négatif.
Par ailleurs, la question de la répartition des ressources financières reste posée, notamment au vu de la situation d’inéquité dans laquelle sont placées certaines communes. De nombreux problèmes restent à résoudre, dans l’attente de la réponse du Gouvernement qui s’est engagé à agir à l’occasion du projet de loi de finances pour 2019.
De plus, avec l’augmentation de la puissance, les effets sont mécaniquement démultipliés sur les populations riveraines, et la distance de sécurité de 500 m minimum entre les habitations et des installations éoliennes apparait aujourd’hui clairement insuffisante.
De nombreuses études, indépendantes, mettent en garde contre les conséquences néfastes d’une exposition constante au bruit et aux infra-sons générés par les éoliennes. Ainsi, alors que le niveau de bruit ambiant extérieur est ordinairement limité à 30 décibels audibles (dBA), les acteurs industriels ont obtenu une dérogation au code de santé publique rehaussant le plafond à 35 dBA ; soit environ trois fois plus, l’échelle de mesure n’étant pas linéaire. Les normes en matière de santé publique ne s’appliquent donc pas aux populations vivant près d’une éolienne. Concernant les infra-sons, causés par le passage des pales devant le mât, ils provoquent ce qui est désormais appelé le syndrome éolien ; celui-ci se manifeste, entre autres, par des maux de tête, des troubles du sommeil, des acouphènes, des troubles de l’humeur… Ses effets ont un impact important sur la vie de tous les jours, et sont observables aussi bien sur les êtres humains que sur les animaux. Par ailleurs, des interrogations se font également jour concernant l’impact négatif d’éoliennes implantées dans les couloirs de migration et de circulation des oiseaux.
Tant l’OMS que l’Académie de médecine ont réclamé, a minima, un triplement de la distance de sécurité pour la porter à 1 500m. La Bavière et la Pologne, entre autres, ont imposé un éloignement correspondant au minimum à 10 fois la hauteur des éoliennes.
Le danger peut également être plus direct, notamment en cas de rupture des mâts. La durée de vie d’une éolienne étant d’environ 20 ans, il y a statistiquement 33 % de chances pour que chacune d’elles connaissent une avarie au cours de son exploitation. Or, de simples calculs balistiques établissent que pour un modèle de 125 m de hauteur, un morceau de pale peut être projeté jusqu’à 1 km, et rebondir encore jusqu’à 300 m, soit bien au-delà des 500 m de précaution. Pour toutes ces raisons, apparaissant très clairement en deçà des exigences minimum de sécurité, la distance minimum de sécurité entre un parc éolien et les zones destinées à l’habitation doit donc être portée à 10 fois la hauteur du mât le plus élevé.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « à 500 mètres » sont remplacés par les mots : « à dix fois la hauteur du mât le plus élevé ».